
|
L Pierre de LESCURE (1891-1963)
Pierre de Lescure naît le 30 mars 1891 en Algérie. A 18 ans, il décide de se préparer à la diplomatie à l’Ecole libre des sciences politiques tout en cultivant de multiples autres centres d’intérêt comme la philosophie ou les « sciences sociales » aux Hautes Etudes. Mais surtout en 1911, lorsqu’il rencontre le père dominicain Antonin-Gilbert Sertillanges auquel il voue une admiration sans bornes pendant 10 ans, il entame des études théologiques. Il devient alors en 1915 secrétaire de rédaction de La Revue des jeunes et s’y consacre au point de créer sa première librairie sise au 3, rue de Luynes et sa première maison d’édition appelée Les Editions de la Revue des jeunes afin d’assurer la pérennité financière de cette revue. Il côtoie ainsi Maurice Barrès, François Mauriac, Claudel, c’est-à-dire une droite catholique et nationaliste. Lui qui se veut une « conscience scrupuleuse » comme en témoigne Vercors dans Les Nouveaux Jours est effaré et scandalisé quand il devient « témoin (involontaire et offusqué) [des] égarements » de son mentor. Il décide de s’en ouvrir aux dominicains qui, loin de le soutenir, le font passer pour fou. Pierre de Lescure est obligé alors d’abandonner la revue en 1923. Il crée une deuxième librairie religieuse : l’Office central de librairie et de bibliographie, rue des Saints-Pères, dont Jean Bruller franchit le seuil en 1926 pour obtenir des souscriptions pour son premier album de dessins 21 Recettes de mort violente. Dans La Bataille du Silence, Vercors se souvient de cette première rencontre avec cet homme « chaleureux et froid » à la fois : « il tournait les pages de mon album, lisant les commentaires, silencieux, impassible, sans sourire une seule fois. […] Quand enfin il eut terminé, il leva ses yeux inquiétants puis, souriant pour la première fois, et le sourire ne faisait qu’agrandir le rectangle de chair sans en changer la forme, il me demanda si j’accepterais d’être attaché à sa librairie ». Cette collaboration ne dure qu’un automne jusqu’à la disparition mystérieuse de Lescure. A son retour, il propose à Jean Bruller d’assumer la direction d’un nouveau département qui « produirait chaque année quelques ouvrages pour bibliophiles ». Le projet n’aboutira jamais et au retour de Lescure, la librairie ne lui appartient plus : son neveu et un ami l’ont fait passer pour fou auprès du conseil d’administration ; l’entreprise appartient désormais à une librairie catholique belge. Lescure s’en explique à son ami : depuis l’affaire Sertillanges, les dominicains sembleraient s’acharner contre chacun de ses projets, que ce soit pour La Quinzaine Critique parue de 1929 à 1932 ou pour la revue Paru qui ne paraîtra jamais: « Il met alors sur pied une revue, La Quinzaine Critique (j’y tiens la rubrique des beaux livres) avec l’aide d’une amie haut placée, qui lui assure le volume de publicité indispensable. Succès. La revue plaît. Sur quoi la dame – très catholique - lui coupe les vivres du jour au lendemain. Mort de la revue, désastre financier pour lui. Heureusement, les éditions Plon lui proposent de la ressusciter sous forme hebdomadaire à grand tirage. Nous y travaillons lui et moi d’arrache-pied tout l’hiver. Mais la veille même de l’impression du premier numéro, le PDG le convoque. Et lui signifie qu’il aura pour tuteur le très réactionnaire – et très catholique- Henri Massis. C’est l’obliger à se soumettre ou se démettre[…]. Il n’hésite pas et sacrifie son avenir et gagne-pain à son intégrité morale » ( Les Nouveaux Jours). Lui qui était toujours tiré à quatre épingles sera désormais « tête au vent, portant chandail à col roulé sous la veste indolente, parfois même portant savates » ( Bataille du Silence). Il coupe tout lien avec le milieu catholique nationaliste qu’il avait côtoyé jusqu’alors. Pour survivre, Lescure vit de sa plume : il publie en 1935 deux romans policiers et le roman Pia Malécot chaleureusement encensé par la critique. Il collabore également à Commune et à Ce soir, deux revues proches des communistes. Il évolue donc politiquement tout en voulant préserver son autonomie d’artiste. Dès le début de la guerre, il participe à la Résistance active au sein du réseau Le Guyon ; il introduit Jean Bruller dans un des réseaux de l’Intelligence Service ; malheureusement la trahison d’un des membres met la filière en sommeil. Cette courte expérience pousse cependant Jean Bruller à persévérer dans la Résistance, quelle qu’en soit la manière. L’occasion lui en est rapidement donnée par son aîné de quinze ans. Pendant l’Occupation, l’amitié entre Jean Bruller et Pierre de Lescure renforcée par leurs multiples rencontres au cours de ces années et leur « grande confiance réciproque » les amènent à collaborer encore une fois ensemble autour de La Pensée libre. Cependant la Gestapo anéantissant leur projet d’une part et la revue n’étant pas assez indépendante vis-à-vis du PCF d’autre part, les deux amis fondent une maison d’édition clandestine qui combattra pour la « pureté spirituelle de l’homme » : les Editions de Minuit (si vous souhaitez en savoir davantage, allez à la page consacrée aux Editions de Minuit). Familier du milieu littéraire, Lescure, sous le nom de Larue, se présente à Debû-Bridel – qui a pour pseudonyme Lebourg- afin de transmettre à Paulhan Le Silence de la Mer, premier volume de leur maison d’édition naissante. En remettant à Lebourg l’unique exemplaire de cette nouvelle, Lescure permet non seulement de diffuser celle-ci qui sera largement polycopiée mais aussi de recevoir les premiers subsides du Pr Debré. Mais, en 1942, pour des raisons de sécurité, Lescure se réfugie dans le Jura. Revenu à Paris à l’automne de la même année, il s’insurge contre le fait que Vercors ait fait diffuser sa nouvelle, passant outre son interdiction. Un premier malentendu s’installe donc entre les deux hommes . Avant de disparaître une seconde fois le 21 juin 1943, il confie l’intérim des Editions de Minuit à Eluard et oppose son veto à la parution du récit des Amants d’Avignon d’Elsa Triolet, publié néanmoins le 25 octobre 1943 (pour en savoir plus, allez au paragraphe consacré au problème de l’indépendance des Editions de Minuit). Cette tension s’accentue quand Lescure fait part à son ami de son intention de faire représenter sa pièce en 3 actes Julma au théâtre Montparnasse au moment même de l’Occupation : « Mais Pierre, ce n’est pas possible, protestai-je. Et le silence ? Vous ne publieriez pas un livre ! -
Ce n’est pas la même chose. -
Mais justement, il me semble, c’est pire : il y
aura des Allemands dans la salle, des officiers S.S, Pierre, des
tortionnaires ! Vous allez jouer pour eux ? » Il souriait, mais je crus déceler dans sa voix une pointe d’irritation » ( La Bataille du Silence). La rupture est consommée dès juin 1945. Après réflexion, il refuse de prendre la direction littéraire des Editions de Minuit désormais officielle. Comme le signale Anne Simonin dans son ouvrage consacré aux Editions de Minuit, il reproche notamment à son ami la présence au sein de la maison d’édition d’Yvonne Paraf que Vercors ne compte pas sacrifier au desiderata de Lescure ; de plus, les parts de la société ont été réparties sans son avis, ce qui est inacceptable pour lui : ne nie-t-on pas son rôle essentiel dans les Editions de Minuit ? , fustige-t-il. Vercors tente d’aplanir ce différend en demandant à Jacques Debû-Bridel de mettre en valeur, dans son Historique des Editions de Minuit, le rôle de Lescure. Ce dernier, n’ayant pas lu cet ouvrage avant sa publication, réagit violemment aux erreurs qu’il dit « innombrables », à l’oubli du dévouement des ouvriers du livre et, sans doute plus encore, il refuse que l’on tire le bilan de « sa » maison d’édition sans lui. Il préfère donc retourner en Suisse avec sa compagne Célia Bertin pour y lancer une nouvelle revue. Sa rancœur s’exprimera dans son roman La Saison des consciences. Vercors y tient le rôle de Conscience, un imposteur. Lescure rétablit ainsi sa vérité dans ce roman polémique. Et il le publie en 1959 au moment où il devient vice-président du CNE alors même que Vercors s’en est éloigné, refusant de servir de « potiche d’honneur ». Cet amoureux de la littérature anglaise qui admire Keats, Katherine Mansfield et Virginia Woolf meurt en 1963 sans avoir revu « le seul homme qui […] avait été profondément [son] ami ». |
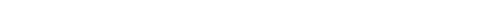
Copyright (c) 2006 N
Gibert. Tous droits réservés.