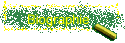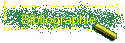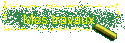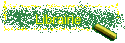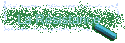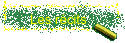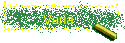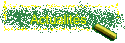ROMANS |
NOUVELLES |
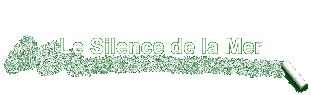
« Ce
film n’a pas la prétention d’apporter une solution au problème des relations
entre la France et l’Allemagne, problème qui se posera aussi longtemps que les
crimes de la barbarie nazie, perpétrés avec la complicité du peuple allemand, resteront
dans la mémoire des hommes… ».
C’est
par cette phrase que commence le film Le Silence de la mer. Ce film est une adaptation du célèbre récit de Vercors publié
clandestinement dans Les Editions de Minuit en février 1942 et il est réalisé
en 1947 par un cinéaste de trente ans encore inconnu, Jean-Pierre Melville.
Melville
lit Le Silence de la mer en
1942 à Londres et il en est bouleversé.
Après la guerre, il décide de se consacrer à sa vocation de cinéaste
qu’il proclame depuis l’âge de six ans et souhaite adapter le récit de Vercors.
Cependant, comme l’écrivain, il crée son œuvre dans la clandestinité. En effet,
il n’obtient pas sa carte de réalisateur qui pourrait lui donner une
autorisation pour son film. C’est la raison pour laquelle il réalise Le Silence de
la mer avec un budget dérisoire
(il n’a pas obtenu les crédits du CNC) dans des conditions d’improvisation qui
marquent une rupture avec le système de production traditionnel français. De
plus, Vercors refuse que son récit soit porté à l’écran. Pour convaincre ce dernier, Melville se rend chez
lui et passe un accord avec lui. Il s’engage à montrer son film à des
résistants et à détruire le négatif si la majorité n’aime pas le film. Vercors
accepte et va même jusqu’à lui prêter pour le tournage la maison dans laquelle
il a écrit le récit. Melville tourne son film en 27 jours en 1947. En 1948, les
résistants choisis par Vercors pour visionner le film accueillent ce dernier
avec enthousiasme. Ainsi, Vercors, après avoir plusieurs fois refusé les droits
d’adaptation, finit par les accorder à Melville. Le Silence de la mer sort en avril 1949. Melville en a fait une
transcription d’une absolue fidélité et la pauvreté des moyens a même servi le
film : le dépouillement convient parfaitement à la nature du sujet. Malgré
une presse très favorable, Melville ne rencontre pas un grand succès avec ce
premier film. Pourtant, il sera par la suite
l’annonciateur de la Nouvelle Vague.
|
Le
Silence de la mer de
Vercors |
Adaptation de Melville. |
|
34 pages : p 17-51. 9 chapitres : -chapitre
1 : p 17-18. -chapitre
2 : p 19 -21. -chapitre
3 : p 22 - 26. -chapitre
4 : p 27-30. -chapitre
5 : p 31-32. -chapitre
6 : p 33-36. -chapitre
7 : p 37-38. -chapitre 8 : p 39. -chapitre
9 : p 41-51. |
Durée : 1h 24 mn. |
|
P 17-18 (chapitre 1) P 17 : A la mémoire de Saint-Pol-Roux
Poète assassiné.
|
Séquence 1 : Un homme marche, dépose une valise devant
un autre homme. Celui-ci l’ouvre et découvre, sous le journal Combat le livre de Vercors Le Silence
de la mer. Chaque nom d’acteurs est ensuite présenté
sur la page d’un livre. Puis vient le texte déjà cité dans la présentation p
2 et la date 1941. Le film cite le texte de Vercors « A la mémoire
de Saint-Pol-Roux Poète assassiné ». Séquence 2 : Vues de la campagne et du village en
hiver. L’oncle est debout dans la neige et
regarde au loin. La voix off déclare :
|
|
P 17-18: situation initiale :
préparatifs de l’arrivée de l’officier allemand Werner von Ebrennac pendant 5
jours.
Séquence 2 : P 19-23 (chapitres 2-3) -arrivée de Werner von Ebrennec. Scène
statique et silencieuse comme le souligne l’anaphore de ces 2 mots.
L’officier comprend et conclut ainsi : « J’éprouve un grand estime
pour les personnes qui aiment leur patrie ». Seul l’oncle brise le silence après le
départ de l’officier lors de leur première rencontre : « Dieu
merci, il a l’air convenable ». |
« Ainsi il se soumet. Voilà tout ce
qu’ils savent faire. Ils se soumettent tous. Même cet homme-là ». Le
film commence donc par la fin du texte de Vercors (p 50). Cette phrase est
d’ailleurs un ajout ultérieur de Vercors pour éviter toute ambiguïté
d’interprétation. Retour en arrière : préparatifs pour
l’arrivée de l’officier : des caisses sont apportées par des militaires,
l’oncle leur montre la chambre que l’on ne voit pas. Séquence 3 : -extérieur de la maison : arrivée de
Werner von Ebrennec. Il frappe à la
porte et la nièce lui ouvre. La musique s’intensifie. Dans l’embrasure de la porte, il se
présente. Silence et immobilité mis en exergue par le tic tac de la pendule.
Il entre et comprend : « J’éprouve un grand estime pour les personnes
qui aiment leur patrie » : visage en contre-plongée qui en accentue
la dureté. Musique douce lorsqu’il regarde l’Ange au
mur. Lorsque la nièce revient après lui avoir
montré sa chambre, l’oncle dit pour la première fois : « Dieu
merci, il a l’air convenable ». |
|
Gradation dans les
visites successives de l’officier à l’oncle et à la nièce : -p 19 : il frappe à
la porte extérieure et la nièce lui ouvre. -p 22 : il frappe à
la porte et il ouvre lui-même comme il le fera pendant 6 mois. La même scène se répète
chaque jour pendant un mois. Séquence
3 : P
23-38 (chapitres 3 à 7). P 23 : « Les
choses changèrent brusquement un soir » : l’officier ne se présente
pas comme à son habitude. Après un long moment, les pas de l’Allemand
viennent de l’intérieur de la maison et il se présente en tenue de ville. Il entame pendant 6 mois
un « interminable monologue » (p 27) : -il donne les raisons
pour lesquelles il aime la France et apprend à ses hôtes qu’il est musicien
(p 25-26). A son départ, l’oncle dit à sa nièce :
« C’est peut-être inhumain de lui refuser l’obole d’un seul mot ».
Indignation de la nièce perceptible à son expression. |
Séquence 4 : Le lendemain, l’officier affirme
qu’il a passé une bonne nuit, sort de
la cuisine où les personnages restent silencieux et fait un salut à travers
la fenêtre fermée. Séquence 5 : Le soir, l’officier ouvre la porte seul et
monte dans sa chambre ; l’oncle et la nièce décident de ne rien changer
à leurs habitudes. Même scène pendant un mois. La fin de leur
rencontre est ponctuée par la même phrase : « Je vous souhaite une
bonne nuit » (comme le récit). Séquence 6 : Neige fine un soir : la caméra est à
l’extérieur de la maison. L’officier regarde par la fenêtre l’oncle et la
nièce parler. On entend leurs voix, mais on ne comprend pas ce qu’ils se
disent. Puis, comme dans le récit, il se présente en civil. Il avoue qu’il a voyagé dans sa jeunesse
et qu’il connaissait toute l’Europe sauf la France (comme le récit). Une
bûche tombe à ce moment précis. A son départ, l’oncle parle à sa
nièce : « C’est peut-être inhumain de lui
refuser l’obole d’un seul mot ». Indignation de la nièce : elle
lève son visage vers son oncle ( de profil). Voix off : « interminable
monologue » : -il aime la France. -il énumère les écrivains français. -il est compositeur. |
|
-il admire la littérature française , la
musique allemande (p 28). |
Séquence 7 : « interminable monologue » (voix
off) : il évoque les écrivains français et la
musique allemande (musique de fond) ; il affirme que ce sera la dernière
guerre entre les 2 pays : gros plan en plongée sur le visage baissé de
la nièce quand il dit : « Nous nous marierons ». Séquence 8 : Paysage de neige : l’oncle
et la nièce se promènent ; le premier décide de rentrer. La nièce avec
son chien marche sur un chemin étroit et enneigé. On la voit de face. Arrive
en face l’officier : montage en plans alternés. Arrêt quand ils se
voient. L’officier la salue. La rencontre est filmée de côté. Silence de la
scène (cf. C/ Les procédés filmiques). Elle ne le regarde pas. La voix off
ajoute que la nièce ne fera pas allusion à cette rencontre. Séquence 9 : Le soir, l’officier veut vaincre le
silence de la France. Il narre un conte pour enfant : La
Belle et la Bête. La nièce est symboliquement habillée en blanc. Tic tac de
l’horloge pendant le récit. La nièce ne semble pas écouter ; l’oncle est
attentif. |
|
-Werner joue de l’harmonium :
« VIIIe Prélude et Fugue ». Il désire faire une musique à la mesure
de l’homme et avoue qu’il ne peut plus se passer de la France, donc de la
nièce puisqu ‘elle est une allégorie de la patrie ( p 31-32). ( regard intense vers la nièce) (p 33-36). Séquence 4 : P 38-51 (chapitre 7 à 9). Retour de l’officier, mais il ne descend
pas voir ses hôtes. L’oncle se rend à la Kommandatur ; il
voit Werner qui le salue, mais ne s’approche pas de lui. La nièce devine et
ne dit rien. - Dernière rencontre ( p
42-51) : Trois jours plus tard, l’Allemand descend.
Quand la nièce entend ses pas, elle lève un regard transparent, puis reste
dans la posture habituelle quand il arrive. Il n’ouvre pas la porte. Silence
pesant. La nièce, pâle et fixant le bouton de la porte,
murmure : « Il va partir ». L’oncle le prie alors d’entrer (p
44). Werner est en uniforme. Il est immobile sauf ses mains. Quand il ordonne
d’ oublier ce qu’il a dit pendant 6 mois, elle arrête son ouvrage et lui
offre son regard. Il baisse les yeux, ébloui. Il raconte sa visite à Paris à
son ami qui a changé et qui veut abattre l’âme de la France. « Il n’y a
pas d’espoir », crie-t-il 3 fois. Il annonce son départ pour le front. Elle murmure « Adieu » quand il
part. La citation d’Anatole France ne
figure pas dans le récit de Vercors. Mais, quand celui-ci l’adapte pour le théâtre, il l’enrichit de quelques
répliques. Quand l’officier se demande où est son devoir, l’oncle fait
référence à un livre d’Anatole France : « Il est beau, pour un
soldat, de désobéir à des ordres criminels ». Tandis que, dans le film,
l’officier ne dit rien et continue à observer l’oncle, dans la pièce de
théâtre, il réplique : « Que…que dites-vous
là ? Désobéir ? Désobéir à la patrie allemande ? Je suis
soldat, Monsieur. Je suis allemand. Ma patrie est l’Allemagne. Désobéir est
impossible ». -p 51 : situation finale en 5 lignes.
L’officier est parti sans les revoir. Dans la cuisine, l’oncle et la nièce
déjeunent en silence. |
Séquence 10 : L’oncle est dans sa chambre lorsqu’il
entend le son de l’harmonium. Il descend en pensant que c’est sa nièce qui
s’est remise à jouer. Arrivé dans la salle, il découvre que c’est l’officier
qui joue le « 8e prélude et fugue » de Bach. Il s’assoit
à sa place habituelle. Tous les deux le regardent ; la nièce est émue.
Werner joue en gros plan, le dos tourné; nimbé de lumière ; contrejour.
Quand il arrête, la nièce baisse la tête. La musique inhumaine de Bach ne peut être
qu’allemande, car elle n’est pas à la mesure de l’homme ; Werner veut
faire une musique à la mesure de l’homme. Séquence 11 : Idem : histoire personnelle ;
tremblement des doigts de la nièce. Séquence 12 : On voit l’officier à travers la
fenêtre, seul. Il tient des livres à la main et les feuillette. Gros plan sur
les couvertures des œuvres qui évoquent la France. Le soir, il descend et lit une page de
Macbeth. Annonce de son départ pour Paris où il
aura le bonheur de voir le mariage de la France et de l’Allemagne. Séquence 13 : A la gare, il attend le train pour Paris. Promenade dans Paris ; visite de monuments : -L’armée française : Austerlitz. -Jeanne d’Arc : « Je suis
envoyée… » -Notre Dame.
Séquence 14 : La voix off souligne que l’officier est
revenu, mais qu’il ne descend plus les voir.
Séquence 15 : L’oncle se rend à la Kommandatur. Un
soldat tape à la machine ; regardant autour de lui, l’oncle voit le
buste de Marianne retourné vers le mur et des affiches antibolchéviques.
Werner entre, le voit, le salue de loin. Séquence 16 : Le soir, la nièce tente de lire ;
elle va se coucher plus tôt et embrasse son oncle. L’oncle, perturbé, s’approche
de l’harmonium et joue quelques notes. Séquence 17 : Trois jours plus tard, ils entendent des
pas irréguliers ; l’officier frappe à la porte, mais n’ouvre pas comme à
son habitude. Le visage de la nièce est tendu vers la
porte ; elle murmure : « Il va partir ». L’oncle se
décide : « Entrez, monsieur ». L’officier reste sur le pas de la
porte ; seules ses mains sont animées de tics nerveux. Il vient dire des
« paroles graves ». La nièce prend son tricot et déroule le fil
interminablement (comme une Parque). Werner : « Tout ce que j’ai dit,
il faut l’oublier ». La nièce le regarde pour la première fois :
yeux éblouissants. Tic tac de
l’horloge qui rend le silence plus pesant. L’officier se protège de sa main, lorsqu’il
voit les yeux de la nièce. Il raconte son séjour à Paris. Séquence 18 : Retour en arrière à Paris. Il
est dans le bureau d’un ami officier qui lui parle de Treblinka : 500
exécutions par jour. Gros plan sur la photo de
Hitler. Dans la rue, visage ému de
Werner qui observe
les panneaux indicateurs allemands. Des soldats allemands se promènent dans
la ville ; les commerces sont fermés. Il voit passer un corbillard et
des blindés. Scène d’intérieur : un officier
chante en allemand accompagné d’une guitare :
« Tu ne sais pas combien je suis bon… ». Pièce à côté :
discussion avec Werner von Ebrennec : « nous ne sommes pas
musiciens »… « il faut détruire la France, son esprit ». Séquence 19 : Retour à la gare. Werner voit
les affiches des fusillés. Retour vers la demeure de ses
hôtes en boitant. Rencontre de 3 vieux sur un pont ; ceux-ci se taisent
à son approche et ne se poussent pas. Au café, Werner achète une boîte
d’allumettes : silence hostile des habitants. Séquence 20 : A nouveau dans la demeure des hôtes.
Werner crie 3 fois : « Pas d’espoir ». Caméra se promenant sur
les reliures des livres : Rousseau, Racine… Il raconte que son ami retrouvé à Paris
était le plus enragé. Ses mains s’entrouvrent. « Montrez-moi où est mon
devoir ». Tous 3 regardent l’Ange au mur. Annonce de son départ pour le front. Il se
dirige vers la porte : « Je vous souhaite une bonne nuit ».
Arrêt : « Adieu » en direction de la nièce. Gros plan sur le
visage de celle-ci en pleine lumière. Elle prononce : « Adieu »
tout bas. Plan sur le châle qu ‘elle a sur ses épaules et sur lequel 2
mains tendues l’une vers l’autre sont imprimées. Séquence 21 : On est dans la chambre de
l’officier pour la première fois. Il ouvre les volets ; la lumière
envahit la pièce. Il met sa boucle de ceinturon et sa casquette. On frappe à
la porte…c’est l’ordonnance qui le salue : « Heil Hitler ». Séquence 22 : Descendu au rez-de-chaussée,
Werner s’arrête devant un livre posé bien en évidence ; il l’ouvre et
lit ces mots : « Il est beau, pour un
soldat, de désobéir à des ordres criminels ». Sur la couverture, il lit
le nom d’Anatole France. Il tourne son visage vers une autre pièce et voit
l’oncle debout, immobile, les mains dans le dos dans l’embrasure de la porte. L’ordonnance revient et affirme
que tout est prêt en souriant. Devant l’absence de réaction de Werner, son
sourire se fige. Werner parle enfin et lui dit qu’il arrive. Il observe une
dernière fois l’oncle, puis part définitivement. Aboiement des chiens, bruit
de moteur pendant que la caméra reste un long moment sur l’oncle toujours
dans la même position figée. Séquence 23 : A la table de la cuisine, l’oncle et la
nièce déjeunent sans parler. Profils en contre-jour. Elle regarde à travers la fenêtre. Voix off : « Dehors luisait au
travers de la brume un pâle soleil. Il me semble qu’il faisait très
froid ». On voit les dernières lignes du livre
juste après avec la date « Octobre 1941 ». Sur la page suivante, on
peut découvrir : « Ce
volume publié
aux dépens d’un
patriote a
été achevé d’imprimer sous
l’occupation nazie le
20 février 1942 ». Une page est tournée et on peut lire le
mot « FIN ». Générique. |
1.
Les décors
Les décors sont peu nombreux. Les
moyens pour réaliser ce film sont certes modestes, mais c’est également un
choix de Melville. Nous découvrons les alentours de la maison de l’oncle
enneigés ou ensoleillés, quelques vues rapides de Paris (monuments et rues), la
forêt lorsque l’officier évoque sa fiancée. Le film n’a pas été tourné en
studio ; les décors sont donc réels et rappellent le néo-réalisme italien.
Les personnages se retrouvent surtout
dans la salle, seule pièce que l’on voit de la maison à l’exception de la
chambre de l’officier au moment de son départ. Cela crée une unité de lieu et
une concentration propice au confinement des personnages et au huis-clos.
L’Allemand et la nièce se rencontrent une seule fois dehors sur un chemin
enneigé. On assiste alors à une rencontre manquée.
2.
La lumière
Alors que l’extérieur est filmé
en lumière naturelle, l’intérieur de la maison est toujours en clair-obscur.
Les blancs et les noirs sont fortement contrastés ce qui accentue les traits du
visage de l’Allemand souvent pris en contre-plongée. L’une de ses premières
entrées est d’ailleurs fantomatique, car on voit son ombre gigantesque sur la
cheminée. Les profils sont toujours en contre-jour, celui de la nièce en
particulier : cela permet de cacher ses yeux. Progressivement, le regard
de la nièce devient de plus en plus intense jusqu’au moment où elle regarde
l’officier lors de leur dernière rencontre. Le gros plan sur son visage est
éblouissant pour l’officier qui ne peut soutenir le regard de celle qu’il aime.
3.
Les plans
La plupart du temps, ce sont des plans
américains ou, plus brutaux, des gros plans sur les visages de l’officier et de
la nièce (plus rare pour l’oncle). Ces gros plans prennent la nièce de profil
puisqu’elle ne daigne pas jeter un regard sur Werner et ce dernier de face. Il
est pris en contre-plongée, soit en entier, soit le visage seulement.
4.
Le montage
Le montage est assez classique
dans l’ensemble ; on peut cependant faire 2 observations :
-
Les
gros plans sur les visages sont soudains. Lorsque Werner se promène dans les
rues de Paris, il observe les panneaux allemands, puis la caméra s’arrête sur
son visage ému, car il a compris les véritables buts de sa patrie. Cela est
encore plus visible dans la maison. A chacun de ses discours, la caméra
s’immobilise sur le visage de l’Allemand qui reste alors silencieux. Le tic tac
continuel de l'horloge souligne davantage cette immobilité et ce silence.
-
Le
croisement de la nièce et de l’officier dans la neige est réalisé en montage
alterné. La nièce et son chien s’avancent sur le chemin enneigé face à la
caméra. Puis, on voit de face l’officier qui marche également. Retour vers la
nièce toujours prise de face, puis vers l’officier qui stoppe lorsqu’il la
reconnaît. Le croisement des 2 personnages se fait de profil : cela met en
relief la vitesse de leur rencontre et son échec. Cette rencontre manquée est
une création de Melville.
5.
Les objets
-
Le feu
dans la cheminée est omniprésent. Cela est logique puisqu’il fait froid
dehors ; cependant, il permet de plonger les personnages dans le
clair-obscur ; il est un prétexte à la venue de l’Allemand qui vient se réchauffer,
sa chambre étant trop froide. L’officier le fixe à chaque fois qu’il parle avec
émotion ou nostalgie. Il l’évoque même quand il compare l’hiver en France et en
Allemagne : « Chez moi on pense à un taureau, trapu et puissant, qui
a besoin de sa force pour vivre. Ici, c’est l’esprit, la pensée subtile et
poétique ». Le feu est la métaphore de la pensée et c'est justement ce que
l'Allemagne veut détruire. D’ailleurs, l’ombre de l’officier apparaîtra comme
une menace sur la cheminée lors de l’une de ses premières visites. Il n’est pas
étonnant que l’affiche du film représente la tenue verte d’un officier dans
l’ombre et des bûches qui flambent à ses pieds.
-
L’Ange
en haut du mur est visible au début et à la fin du film. Lors de la première
rencontre de l’officier, l’oncle et la nièce lui opposent silencieusement un
refus. La caméra se fixe alors en gros plan et en contre-plongée sur le visage
de Werner : « J’éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment
leur patrie ». Ses yeux se dirigent vers l’Ange ( comme dans le récit de
Vercors). A la fin, dès qu’il évoque de nouveau la question du devoir, son
regard se tourne encore vers cet Ange.
-
Les
livres, symbole de l’esprit (=Geist), sont omniprésents. Dans la salle sont
alignées des œuvres de littérature française qui sont ostensiblement montrées
par la caméra à la fin dès que l’officier crie qu’il n’y a pas d’espoir.
L’oncle est souvent filmé avec un livre à la main et c’est lui qui prend
l’initiative de laisser bien en vue le livre d’Anatole France. C’est également
une mise en abyme du livre de Vercors aux séquences 1 et 23 du film. Melville
rend ainsi un hommage à Vercors.
-
L’harmonium,
discrètement présent au début bien qu’il soit souvent dans le champ de la
caméra, est mis en exergue au moment où l’officier joue « 8e
Prélude et Fugue »de Bach. On sait qu’il est lui-même compositeur et
qu’il considère la musique comme le symbole de l’Allemagne comme la littérature
est celui de la France. Il crée aussi une unité autour de ces 3 personnages,
car la voix off apprend que la nièce sait en jouer et l’oncle joue quelques
notes à la séquence 16 qui est une création de Melville.
-
L’horloge
émet un tic tac régulier qui accentue le silence et rend pesante l’immobilité
des personnages.
6.
La musique
La musique joue un rôle très
important. La musique symphonique est une tradition qui vient de l’Allemagne,
illustrée par Beethoven et Brahms. Elle est une tradition dans les films français et hollywoodiens (des
compositeurs comme Max Reinhard se sont réfugiés aux Etats-Unis). Elle joue un
rôle émotionnel très subjectif surtout lorsque la caméra filme les visages en
gros plan. Et nous avons déjà dit que la musique, qui unit les 3 personnages,
est une allégorie de l’Allemagne.
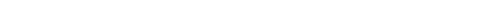
Copyright (c) 2006 N
Gibert. Tous droits réservés.